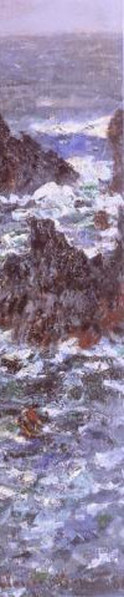
Je le revois comme si c’était hier, arrivant d’un pas lourd à la porte de l’auberge, suivi par une brouette qui portait son coffre de marin. L’homme était grand, vigoureux et corpulent. Il avait le teint bistre, les cheveux noués en une queue poisseuse qui retombait sur le col d’un habit bleu couvert de taches, des mains rugueuses et couturées, des ongles noirs et cassés et, en travers de la joue, la marque laissée par un sabre, d’un blanc sale et livide. Je le revois parcourir des yeux la crique tout en sifflotant, puis, de cette voix aiguë et chevrotante qu’il semblait avoir accordée puis brisée en virant au cabestan, il entonna la vieille chanson de marin qu’il devait reprendre si souvent par la suite :
Z’étions quinz’ homm’ su’ l’coff’ du mort
Hisse et ho ! – et une bouteille d’rhum !
Ensuite, à l’aide d’un bâton qu’il tenait à la main, en forme d’anspect, il frappa à la porte et, à l’arrivée de mon père, réclama avec rudesse un verre de rhum. Dès qu’il fut servi, l’étranger le but lentement, le dégustant en connaisseur, sans cesser pour autant d’observer les falaises et l’enseigne de l’auberge.
« Epatante, cette crique, finit-il par dire. Joliment située aussi, c’tte réserve à rhum. Beaucoup d’passage, camarade ? »
Mon père répondit que non, très peu de passage, si peu que c’en était misère.
« Eh bien ! alors, reprit-il, c’est just’ l’mouillage qu’i m’faut. Hé l’ami ! » cria-t-il à l’homme qui poussait la brouette, « accoste ici et aide-moi à débarquer mon coffre. J’vais rester un peu ici, poursuivit-il. J’suis pas difficile : du rhum, du lard et des œufs, m’en faut pas plus, et aussi c’tte falaise là-haut pour guetter les navires qui passent au large. Comment qu’vous pourriez m’appeler ? Vous pourriez m’appeler capitaine. Ouais, j’vois bien c’qui vous tracasse… Tenez ! » (Et il jeta trois ou quatre pièces d’or sur le pas de la porte.) « N’aurez qu’à me dire quand elles auront fait leur temps », ajouta-t-il, avec toute la brutalité d’un commandant de navire.
[…]
En temps ordinaire, il était des plus taciturnes. Il passait ses journées à traîner autour de la crique ou sur les falaises, muni d’une longue-vue, et le soir, il restait assis dans un coin de la salle commune, près du feu, à boire des grogs bien tassés. La plupart du temps, il ne répondait pas quand on lui adressait la parole, mais se contentait de relever brusquement la tête d’un air féroce, et de souffler par le nez en imitant l’appel d’une corne de brume. Nous apprîmes bien vite à ne pas le déranger, suivis en cela par nos clients. Chaque jour, au retour de sa promenade, il nous demandait s’il n’était pas passé quelque marin sur la route. Nous crûmes d’abord qu’il posait la question parce que la compagnie de ses semblables lui manquait, mais nous finîmes par comprendre qu’il était plutôt désireux de la fuir. Quand un marin descendait à L’Amiral Benbow – comme le faisaient parfois ceux qui gagnaient Bristol par la côte -, il l’épiait en écartant le rideau de la porte avant d’entrer dans la salle. Et tant que le marin restait là, il demeurait muet comme une carpe. Pour moi, en tout cas, il n’y avait rien de mystérieux dans sa conduite, puisqu’il avait fait de moi, en quelque sorte, son confident, en m’avouant ses craintes. Un jour, il m’avait entraîné à l’écart, promettant de me remettre une pièce d’argent de quatre pence le premier de chaque mois, si je voulais bien « ouvrir grandes mes écoutilles » et l’avertir dès que je verrais se présenter « un marin à une seule jambe ». Bien souvent, lorsque arrivait le premier du mois et que je lui réclamais mon salaire, il se contentait de souffler par le nez en me foudroyant du regard ; mais la semaine n’était pas écoulée qu’il se ravisait et me remettait la pièce promise, en me réitérant l’ordre de veiller au « marin à une seule jambe. »
Robert Louis Stevenson, L’Île au trésor, 1883 (traduit de l’anglais par Marc Porée).
Z’étions quinz’ homm’ su’ l’coff’ du mort
Hisse et ho ! – et une bouteille d’rhum !
Ensuite, à l’aide d’un bâton qu’il tenait à la main, en forme d’anspect, il frappa à la porte et, à l’arrivée de mon père, réclama avec rudesse un verre de rhum. Dès qu’il fut servi, l’étranger le but lentement, le dégustant en connaisseur, sans cesser pour autant d’observer les falaises et l’enseigne de l’auberge.
« Epatante, cette crique, finit-il par dire. Joliment située aussi, c’tte réserve à rhum. Beaucoup d’passage, camarade ? »
Mon père répondit que non, très peu de passage, si peu que c’en était misère.
« Eh bien ! alors, reprit-il, c’est just’ l’mouillage qu’i m’faut. Hé l’ami ! » cria-t-il à l’homme qui poussait la brouette, « accoste ici et aide-moi à débarquer mon coffre. J’vais rester un peu ici, poursuivit-il. J’suis pas difficile : du rhum, du lard et des œufs, m’en faut pas plus, et aussi c’tte falaise là-haut pour guetter les navires qui passent au large. Comment qu’vous pourriez m’appeler ? Vous pourriez m’appeler capitaine. Ouais, j’vois bien c’qui vous tracasse… Tenez ! » (Et il jeta trois ou quatre pièces d’or sur le pas de la porte.) « N’aurez qu’à me dire quand elles auront fait leur temps », ajouta-t-il, avec toute la brutalité d’un commandant de navire.
[…]
En temps ordinaire, il était des plus taciturnes. Il passait ses journées à traîner autour de la crique ou sur les falaises, muni d’une longue-vue, et le soir, il restait assis dans un coin de la salle commune, près du feu, à boire des grogs bien tassés. La plupart du temps, il ne répondait pas quand on lui adressait la parole, mais se contentait de relever brusquement la tête d’un air féroce, et de souffler par le nez en imitant l’appel d’une corne de brume. Nous apprîmes bien vite à ne pas le déranger, suivis en cela par nos clients. Chaque jour, au retour de sa promenade, il nous demandait s’il n’était pas passé quelque marin sur la route. Nous crûmes d’abord qu’il posait la question parce que la compagnie de ses semblables lui manquait, mais nous finîmes par comprendre qu’il était plutôt désireux de la fuir. Quand un marin descendait à L’Amiral Benbow – comme le faisaient parfois ceux qui gagnaient Bristol par la côte -, il l’épiait en écartant le rideau de la porte avant d’entrer dans la salle. Et tant que le marin restait là, il demeurait muet comme une carpe. Pour moi, en tout cas, il n’y avait rien de mystérieux dans sa conduite, puisqu’il avait fait de moi, en quelque sorte, son confident, en m’avouant ses craintes. Un jour, il m’avait entraîné à l’écart, promettant de me remettre une pièce d’argent de quatre pence le premier de chaque mois, si je voulais bien « ouvrir grandes mes écoutilles » et l’avertir dès que je verrais se présenter « un marin à une seule jambe ». Bien souvent, lorsque arrivait le premier du mois et que je lui réclamais mon salaire, il se contentait de souffler par le nez en me foudroyant du regard ; mais la semaine n’était pas écoulée qu’il se ravisait et me remettait la pièce promise, en me réitérant l’ordre de veiller au « marin à une seule jambe. »
Robert Louis Stevenson, L’Île au trésor, 1883 (traduit de l’anglais par Marc Porée).